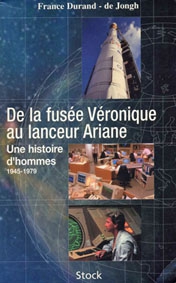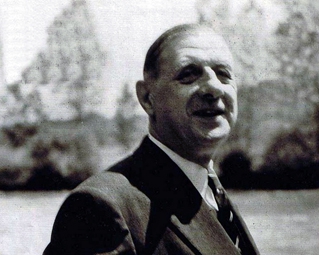De la fusée Véronique au lanceur Ariane : livre de France Durand-de Jongh
Déboires et défaites d'un lanceur Européen extrait du livre de France Durand-de Jongh
Tout commence par une histoire anglaise. Au début des années soixante, alors que l'Europe de l'espace n'est encore qu'une vague idée, les Britanniques décident de renoncer au profit du Polaris américain à leur missile stratégique Blue Streak, un engin balistique performant développé à grand renfort de moyens coûteux avec, dans un premier temps, le concours des États-Unis.
missile Polaris devant Blue Streak à Edinbourg East fortune
Équipé de moteurs à turbopompe Rolls-Royce, doté d'une structure légère, le Blue Streak répondait à des ambitions militaires précises. Il s'agissait de développer une force de frappe autonome qui nécessitait la mobilisation d'un personnel nombreux et de lourds investissements. Sa mise en œuvre sur la base australienne de Woomera (Commonwealth oblige) en faisait un instrument luxueux d'un point de vue budgétaire. Autant de raisons qui incitèrent les autorités britanniques à vouloir placer leur engin entre les mains d'une Europe qui attendait son lanceur comme un enfant prodigue. C'est après l'offre des Anglais que le général de Gaulle donna son accord à la mise sur pied d'une Europe spatiale, préalable à la création de l'ELDO. Avec le Blue Streak venu d'outre-Manche, la nouvelle organisation disposait d'un premier étage tout prêt. Il suffisait que la France y accolât un deuxième étage (ce fut Coralie) et les Allemands un troisième étage (baptisé Astris) pour qu'une fusée du nom d'Europa pointât son nez vers le ciel. grâce aux travaux du groupe Fiat, devait concevoir la coiffe. La Belgique se chargea du système de guidage radioélectrique et les Pays-Bas, via Philips, fournit le matériel de télémesure. Naquit ainsi un engin décentralisé, désarticulé, dépaysé. D'où il advint qu'il échoua dans la plupart de ses missions, sous sa forme initiale d'Europa I ou plus sophistiquée (plus chère aussi) d'Europa II; Europa III ayant succombé avant même d'atteindre le pas de tir.
Avec le recul des années, les acteurs de ces programmes s'accordent à reconnaître qu'ils étaient condamnés d'avance, tant l'absence d'un maître d'oeuvre unique ouvrit la porte aux prétentions nationales mâtinées d'égoïsme, d'indiscipline et parfois d'incompétence; l'esprit de clocher l'emportant sur la notion d'intérêt européen, sinon général. Certes, les équipes d'ingénieurs et de techniciens impliquées dans les Europa continuèrent d'apprendre et de comprendre les phénomènes spatiaux. L'expérience qu'elles accumulèrent dans un contexte de chacun pour soi fit que le jour venu, lorsque des structures ad hoc leur permirent de s'exprimer pleinement, elles réussirent à unir leurs savoirs et leurs volontés pour construire un lanceur de substitution que le ministre du Développement industriel Jean Charbonnel appellerait Ariane.
Mais nous n'en sommes pas encore là. Dans ce début des années soixante, face à la double suprématie américano-soviétique, l'Europe veut à tout prix exister dans l'espace. Les Anglais mettent à sa disposition leur Blue Streak, moins par fibre européenne que par souci financier d'alléger le poids d'un engin aussi beau que dispendieux. Ici se joue, en négatif, le sort peu enviable des premiers lanceurs européens. Alors que les professionnels français se refusaient à prendre le Blue Streak comme base de départ, le général de Gaulle, à la surprise de tous, et pour le plus grand soulagement des Britanniques, décida seul d'adopter cette solution. (Encore faut-il souligner que tous les tirs du Blue Streak furent parfaitement réussis.) D'emblée, le futur lanceur européen portait la trace du péché originel, une faille qui irait grandissante, malgré les efforts des hommes du CNES. Dès la naissance d'Europa, l'échec était inscrit. Les manquements de l'ELDO seraient fatals aux ambitions les plus élevées.
Au début de cette pénible affaire, on trouve donc la surprenante décision du président français d'accéder aux désirs des Britanniques. Mal lui en prit, si l'on en juge par la suite, mais déjà par les craintes qui prévalaient parmi les responsables de l'époque. Le témoignage du général Aubinière est, de ce point de vue, éloquent :
«Les Anglais, se souvient-il, sont venus proposer leur lanceur au ministre des Armées Pierre Guillaumat. A la demande de ce dernier, j'ai assisté à l'entretien avec un ingénieur, Paul Faisandier. Après avoir entendu leur exposé
, nous avons rédigé un rapport négatif. Notre opinion était faite : il ne fallait pas participer. Nous avancions plusieurs raisons à ce refus. Le Blue Streak était un lanceur de faible capacité. Or les Britanniques le considéraient d'emblée comme un premier étage de fusée. Nous savions dès lors que la France, pressentie dans ce schéma pour réaliser le deuxième étage, ne jouerait qu'un rôle modeste. Pareille solution n'offrait que peu d'intérêt. N'étions-nous pas déjà engagés dans un programme militaire coûteux? Bref, nous tombâmes d'accord avec Pierre Guillaumat : ce serait "non". »
Michel Bignier confirme et précise cette position : « Les armées françaises n'étaient pas emballées par le projet. La technologie employée pour le Blue Streak paraissait obsolète, et les Anglais se taillaient la part du lion comparée à celle des Français et des Allemands. Nous étions surtout indispensables pour le financement du programme [...]. En revanche, il était intéressant de posséder un lanceur qui ne soit pas acheté aux États-Unis, et capable de placer des satellites sur orbite. » Oui, mais à quel prix?
Pierre Messmer en convient volontiers. «Pas un seul spécialiste ne prenait au sérieux le programme ELDO, affirme-t-il. Un système qui consiste à construire un étage de fusée par pays relevait d'une mauvaise méthode. Chacun convient aujourd'hui qu'elle fut absurde. Il aurait fallu une chance incroyable pour que cela marche. L'opération était vouée à l'échec. Sagement, les Armées n'y ont jamais mis un sou [...]. »
Il faut croire pourtant que cet échec cuisant était un « passage obligé », le labyrinthe d'où sortirait, accrochée à son fil ténu, la belle Ariane. Sans la masse cumulée de ces insuccès, qui finirent par donner aux hommes une expérience hors du commun, le lanceur européen n'aurait jamais vu le jour. C'est au cours d'un tête-à-tête au château de Rambouillet avec le Premier ministre britannique MacMillan que le général de Gaulle, ignorant l'avis de ses conseillers, donna son accord aux Britanniques à propos du Blue Streak.
 dessin satirique de Cummings dans le London daily express en octobre 1960 ( Bien sur, je parlerai de votre offre au général, Mr Macmillan mais il est presque déjà dans l'espace!)
dessin satirique de Cummings dans le London daily express en octobre 1960 ( Bien sur, je parlerai de votre offre au général, Mr Macmillan mais il est presque déjà dans l'espace!)
« Là, nul au monde ne sut ce qui fut dit, mais la France donna un avis favorable : c'était oui ! » s'étrangle encore Robert Aubinière. Dans le premier tome de son ouvrage C'était de Gaulle, Alain Peyrefitte apporte un précieux éclairage sur l'état d'esprit du président français : « Après le conseil, le général revient devant moi sur le problème de fond : "J'ai eu la faiblesse d'accepter d'Harold. MacMillan que nous reprenions aux Anglais leur fusée Blue Streak dont ils ne savent plus que faire. Je m'en veux. Maintenant, nous en sommes bien embarrassés. Ça coûte cher et nous ne sommes pas sûrs des résultats. Enfin, puisqu'on a commencé, il faut bien continuer [...]. »
Le général de Gaulle ne fera plus état de ses remords ni de ses états d'âme à propos du Blue Streak, et son aveu de faiblesse ne recevra aucun écho, ainsi qu'en témoigne Michel Bignier :
« Par voie hiérarchique, explique-t-il, le général Aubinière avait envoyé une note à de Gaulle qui disait en substance : "J'ai des doutes sur la sincérité des Britanniques. Leur motivation semble se résumer à un aspect médiatique. Ils veulent montrer à leur opinion que leur Blue Streak est utile. Je ne crois pas qu'ils mèneront le programme à son terme." le général de Gaulle avait retourné la lettre accompagnée de quelques lignes manuscrites ainsi libellées : "La décision est prise. Il faut réaliser le programme Europa. Si d'aventure les Anglais reniaient leur parole, il ne serait que de dénoncer la convention ELDO et de travailler seuls !" »
Le général Aubinière remâche sa déception : « C'est ainsi que la France donna son accord à l'Angleterre. » Il s'ensuivit une période de négociations qui se prolongea pendant toute une année, suivie de la conférence de Strasbourg qu'organisèrent la France et la Grande-Bretagne du 30 janvier au 2 février 1961. Conscient des critiques formulées par ses conseillers, de Gaulle profita de cette occasion pour ouvrir le projet à d'autres pays et inciter les différents participants à développer des technologies plus avancées. Brisant le face-à-face franco-britannique (où la France avait tant à perdre), il accueillit à bras ouverts la RFA, la Belgique, le Danemark et la Norvège, l'Italie et l'Espagne, ou encore la Suède, la Suisse et les Pays-Bas. Tous furent conviés à la création d'une organisation européenne pour la mise au point et la construction d'engins spatiaux. La conférence de Lancaster House, en novembre 1961, devait régler les derniers préliminaires à la signature d'une convention.
Le coût initial prévu pour développer le lanceur s'élevait à 196 millions d'unités de compte 1, débloquées sur cinq ans.
1. Une unité de compte représente environ 6,50 FF.
Le compromis permit certes d'améliorer la proposition des Britanniques tout en réduisant leur influence, mais l'entrée en lice des Allemands, des Italiens et consorts ne laissait pas d'inquiéter quant à l'harmonie future de l'ensemble...
Au final, sept États signèrent la convention du 29 mars 1962, ratifiée le 29 février 1964, portant création du CECLES/ELDO : l'Australie, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la RFA et le Royaume-Uni. Plusieurs règles fondamentales présidaient à la nouvelle entité : constituée à des fins exclusivement pacifiques, elle visait la fabrication d'un lanceur dont le premier étage serait anglais, le deuxième français et le troisième allemand; les autres pays membres se voyant chargés de construire des satellites. C'est de la base de Woomera, en Australie, que le lanceur serait tiré. Le lei mai 1964, l'ELDO nomma son premier directeur général, l'ambassadeur italien Renzo Carrobio Di Carrobio.
Après les accords de Meyrin de 19601 était née une seconde organisation spatiale, le CERS/ESRO, placée sous la direction du Pr Pierre Auger et spécialisée dans la fabrication de satellites à vocation scientifique. Signée le 14 juin 1962, la convention rassemblait neuf États membres : la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, la RFA, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse. Plus tard viendrait le Danemark.
1. Conférence intergouvernementale de Meyrin (Suisse) mettant en place la COPERS (Commission préparatoire européenne pour la recherche spatiale).
Peu après, le 22 mai 1963, fut créée la CETS (Conférence Européenne intergouvernementale pour les Télécommunications par Satellites), ébauche d'une réplique du Vieux Continent à INTELSAT1 placé sous contrôle américain.
Pour la première fois dans l'histoire, une Europe spatiale pacifique émergeait, dotée de structures spécifiques. La situation franco-française était loin d'être simple. Puisque l'ELDO relevait d'une ambition civile, seul le CNES, entité civile, pouvait en son sein représenter la France. Mais notre pays se trouvait engagé simultanément dans deux filières de lanceurs : l'une purement française avec Diamant A et B, l'autre découlant de sa participation à l'ELDO et son programme européen civil de lanceur de satellites à trois étages : Europa I. Dans ce schéma, le deuxième étage, Coralie, était issu de la fusée Véronique déjà développée par le LRBA et la DEFA (Direction des études et fabrication d'armement). « Une situation délicate à gérer, se souvient le général Aubinière. La direction des Engins, structure militaire, détenait Coralie. » Moins qu'un problème d'hommes, c'est donc un problème d'organisation qui se posait de façon cruciale, sans oublier l'apprentissage difficile des pièges du métier.
Mais les échecs successifs du premier puis du second tir de Coralie contribuèrent à clarifier les choses. « La direction des Engins refusa d'accompagner les hommes du CNES devant le conseil de l'ELDO afin d'expliquer ces défaillances techniques, raconte le général Aubinière. Elle estimait que cette question n'était pas du ressort des Armées. A ce moment-là, j'ai décidé que Coralie serait de notre entière responsabilité. J'ai pris contact avec la SEREB, qui a accepté mon offre, à condition de demeurer maître d'oeuvre de la fusée. Les équipes se sont mises en place, dirigées au CNES par Charles Bigot, et à la SEREB par Charly Attali. »
Charles Bigot et le général Aubiniére à Kourou
C'est ainsi que par une sorte d'ironie de l'histoire, la SEREB devint sous-contractant du CNES. Tant bien que mal, et plutôt mal que bien, des États se mirent séparément à construire des étages de fusée, chacun empêtré dans ses contraintes politiques, ses choix d'hommes et de technologies. L'Europe spatiale naissante était un drôle de caméléon.
Les témoignages qui suivent donnent une idée de la difficulté des protagonistes à s'accorder sur un programme commun, tant leurs points de vue mais aussi leur stade d'avancement technique pouvaient diverger, en dépit parfois de la meilleure volonté du monde, comme ce fut le cas des Allemands.
Responsable des affaires bilatérales spatiales, Reinhard Loosch souligne que la coopération scientifique franco-allemande avait débuté dès 1955 avant de se poursuivre au CERN de Genève que fréquentèrent des physiciens et savants des deux pays. « Il fut beaucoup plus difficile de faire s'entendre les industriels », reconnaît-il. Son compatriote Helmuth Dederra retrace les étapes cruciales de cette période controversée
Helmuth Dederra